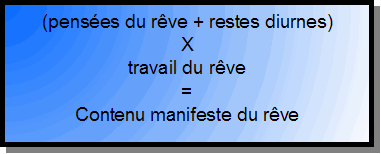|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-
L'INTERPRETATION DES RÊVES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A-
L'INTERPRETAION SELON FREUD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il
semble que le rêve ait un sens, mais un sens
caché, qui se
substitue à un autre processus de pensée et qu'il
n'est,
pour comprendre exactement ce sens caché, que de savoir
comment
c'est faite la substitution.
1
) On distingue deux
interprétations :
-L'interprétation
symbolique : on
considère le contenu du rêve
comme un tout et cherche à lui substituer un contenu
intelligible et en quelque sorte analogue. Cette
interprétation
échoue devant les rêves qui ne sont pas seulement
incompréhensible, mais encore confus. Exemple de Joseph dans
la
Bible : Pharaon rêve de sept vaches maigres
dévorant
sept vaches grasses : c'est une prédiction
symbolique des
sept années de famine en Egypte qui dévorerait
tout ce
que les années d'abondance ont accumulés de
réserve. La plupart des rêves artificiels
crées par
les poètes sont destinés à
être ainsi
interprétés symboliquement : ils rendent
la
pensée de l'auteur sous un déguisement
où notre
expérience découvre les caractères de
nos propres
rêves. Le succès de cette méthode
d'interprétation dépend de
l'ingéniosité,
de l'intuition immédiate.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-La
méthode de déchiffrage : on
considère le rêve comme
un écrit chiffré où chaque signe est
traduit par
un signe au sens commun, grâce à une clef fixe. On
tient
en compte, non seulement du contenu du rêve, mais encore de
la
personnalité et des circonstances de la vie du
rêveur : tel détail a une autre
signification pour
l'homme riche, marié que pour l'homme pauvre,
célibataire. La caractéristique de ce
procédé est que l'interprétation ne
porte pas sur
l'ensemble du rêve, mais sur chacun de ses
éléments, comme si le rêve
était un
conglomérat où chaque fragment doit
être
déterminé à part. Ce sont
très certainement
les rêves discordants et confus qui ont fait naître
l'idée de la méthode de déchiffrage.
Ces deux procédés populaires d'analyse du
rêve sont
évidemment tout à fait inutilisables pour la
recherche
scientifique. La méthode symbolique est d'une application
limitée, on ne peut en faire un système
général. La méthode de
déchiffrage
dépend elle tout entière de la clef,
« clef
des songes » et rien ne garantit celle-ci.
L'interprétation freudienne est une analyse
« en
détail » et non « en
masse »,
elle considère le rêve comme un
conglomérat de
faits psychiques. Les rêves des adultes sont le plus
incompréhensible et ne ressemblent guère
à la
réalisation d'un désir. En effet, pour Freud, le
rêve n'est que l'accomplissement
(déguisé) d'un désir
(refoulé). Les
rêves
d'adultes ont subi une
défiguration, un déguisement : leur
origine
psychique est très différente de leur expression
dernière. Il y a donc d'une part le rêve tel qu'il
nous
apparaît, le « contenu
manifeste » et
l'ensemble des « idées
oniriques latentes »,
que l'on suppose présider au rêve du fond
même de
l'inconscient. Le contenu manifeste du rêve est le substitut
altéré des idées oniriques latentes et
cette
altération est l'œuvre d'un « moi » qui se
défend. Elle naît de
résistances qui interdisent absolument aux désirs
inconscients d'entrer dans la conscience à l'état
de
veille ; mais, dans l'affaiblissement du sommeil, ces forces
ont
encore assez de puissances pour imposer du moins aux désirs
refoulés un masque qui les cache et les rend
incompréhensible à la conscience du
rêveur.
Il suffit de substituer au contenu manifeste si abracadabrant le sens
profond pour que tout s'éclaire : on voit que les
divers
détails du rêves se rattachent à des
impressions de
jours précédents (surtout la veille) et
l'ensemble
apparaît comme la réalisation d'un
désir
insatisfait et d'évènements de la veille.
On peut donc écrire:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
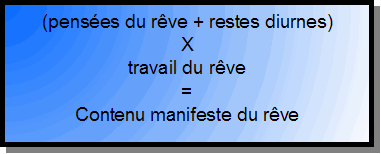 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Deux
grandes forces concourent à la formation d'un
rêve :
les tendances et le système. L'une construit le
désir
exprimé par le rêve, l'autre le censure
et par suite
cela déforme l'expression du désir.
Le « travail onirique » consiste
au passage des
idées inconscientes en contenu manifeste. Il existe deux
processus essentiels : la condensation
et le déplacement. Ce travail
est semblable au travail
d'altération qui transforme les complexes
refoulés en
symptômes, lorsque le refoulement échoue. Il faut
vraiment
comparer le rêve à l'écrivain qui
redoutant la
censure, modère et déforme l'expression de sa
pensée. L'inconscient se sert, surtout pour
représenter
les complexes sexuels, d'un certain symbolisme, qui parfois varie
d'une personne à
l'autre mais qui a aussi des traits généraux et
se
ramène à un certain type de symbole.
L'empereur et l'impératrice, le roi et la reine
représentent le plus souvent les parents du
rêveur ;
il est lui-même le prince ou la princesse. La même
haute
autorité peut-être attribuée
à des grands
hommes. Tous les objets allongés ;
bâtons, troncs
d'arbres, parapluies (à cause du déploiement
comparable
à celui de l'érection), toutes les armes longues
représentent le membre viril. Les boîtes, les
coffrets,
les caisses, les armoires, les poêles, les chambres
représentent le corps de la femme. L'acte sexuel est
représenté, lui, par la lime à ongle,
les sentiers
escarpés, les échelles et bien sûr,
symbole phare
de Freud, l'escalier. La description des différentes
entrées et sorties ne peut pas tromper : on
comprend
dès lors l'importance de savoir si la pièce est
fermée ou ouverte…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
) Le travail de condensation :
Le rêve est
bref , pauvre, laconique, comparé à
l'ampleur et
à la richesse des pensées du rêve.
Écrit, le
rêve couvre à peine une demi-page ;
l'analyse,
où sont indiquées ses pensées, sera,
six ou sept
fois plus étendue. Le rapport peut varier avec les
rêves,
mais ainsi que Freud a pu s'en rendre compte, il ne s'inverse jamais.
En général, on sous-estime l'étendue
de cette
compression ; on considère qu'il n'y a pas d'autres
éléments que les pensées
découvertes, on
néglige toutes celles qui sont cachées
derrière le
rêve et qu'une interprétation plus
étendue pourrait
nous découvrir. Faut-il expliquer la disproportion entre le
contenu du rêve et les pensées du rêve
exclusivement
par un travail de condensation énorme du
matériel
psychique ? Nous avons bien souvent l'impression que nous avons
oublié la plus grande partie de nos rêves. Le
rêve
que nous nous rappelons au réveil ne serait alors qu'un
reste de
l'ensemble du travail du rêve, qui aurait la même
étendue que les pensées si nous pouvions les
rappeler
tout entier. Tout le monde a pu constater qu'un rêve est
reproduit plus fidèlement, lorsque l'on cherche à
se le
rappeler au réveil, que vers le soir où nous n'en
retrouvons que quelques bribes. Le fait que nous pouvons oublier nos
rêves ne contredit d'ailleurs nullement
l'hypothèse d'une
condensation, celle-ci demeure prouvée par la
quantité
des représentations appartenant aux fragments non
oubliés
du rêve. Même si une grande part du rêve
a
échappé à la remémoration,
cela ne peut que
nous avoir ôter l'accès à un autre
groupe de
pensées. Rien, en effet, ne prouve que les parties
oubliées se rapportent aux pensées que celles que
l'analyse de ce qui subsiste nous à permis d'atteindre.
Exemple
de
condensation : Freud
rêve qu'il est assis dans un compartiment de train et qu'il a
sur
ses genoux un chapeau haut-de-forme transparent. Voici comment il
interprète cette condensation. D'une part, le chapeau
évoque la respectabilité, d'autre part, il est
transparent. Ses associations lui évoquent un bec Auer
utilisé pour les expériences de chimie. Cet
instrument
avait été inventé par un
médecin
contemporain de Freud qui en avait tiré profit et gloire.
Comme
Auer, Freud désirait faire fortune avec une invention qui
lui
assurerait la considération de ses concitoyens.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3)
Le travail de déplacement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En
rassemblant des exemples de condensation dans le
rêve, nous avons remarqué que les
éléments
qui nous paraissaient essentiels pour le contenu ne jouaient dans les
pensées du rêve qu'un rôle
très
effacé. Inversement, ce qui est visiblement l'essentiel des
pensées du rêve n'est parfois pas du tout
représenté dans celui-ci. Le rêve est autrement
centré, son contenu est
rangé autour
d'éléments autres que les pensées du
rêve.
Nous savons bien quels sont les éléments
essentiels, nous
le savons d'une manière immédiate. Or, lors de la
formation du rêve, ces éléments
chargés d'un
intérêt intense, peuvent être
traités comme
s'il n'avaient qu'une faible valeur, et d'autres, peu importants dans
les pensées du rêve, prennent leur place. Il
semble
d'abord que l'intensité psychique des diverses
représentations ne joue aucun rôle pour leur choix
dans le
rêve et que joue uniquement la complexité de leur
détermination. Les détails du contenu manifeste
sont
assez révélateurs du contenu latent le plus
important.
Dans l'analyse, on privilégie donc l'étude des
éléments les plus insignifiants pour remonter au
contenu
latent. De ce fait, on a des déplacement de
pensées et de
désirs interdits ou conflictuels sur des objets
anodins
pour les rendre acceptables au conscient. On pourrait supposer que ce
qui apparaît dans le rêve n'est pas ce qui
était
important dans les pensées du rêve, mais
plutôt ce
qui y était souvent répété.
Le processus primaire rassemble trois transformations plus
une :
-la figuration du
rêve :
En effet, le rêve ne présente que des
éléments figurés (perçus et
surtout visualisés).
Le rêve raconte à la façon du film
muet, il peut
citer, répéter des paroles réellement
prononcées, mais il lui faut absolument montrer à
nos
sens ce qu'il raconte. S'il doit dire que quelqu'un n'est pas
là, il le mettra en scène puis le fera
disparaître.
De même, toute formulation abstraite sera
illustrée, se
verra remplacer par un élément ou ensemble
concret comme
un emblème, un symbole, une métaphore, etc...
-la condensation
-le déplacement
-la séquence dans laquelle sont rassemblés les
éléments inconscients qui forment un
rêve se
présente élaborée secondairement, de
façon
le plus souvent rudimentaire, en un scénario narratif ou
dramatique que Freud nomme, la « façade
du
rêve », le minimum formel
nécessaire pour que
cela puisse être raconté.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4)
Un rêve et son interprétation :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« Je
veux donner un dîner, mais je n'ai pour toute provision qu'un
peu
de
saumon fumé. Je voudrais aller faire des achats, mais je me
rappelle que c'est dimanche après-midi et que toutes les
boutiques sont fermées.
Je veux téléphoner à quelques
fournisseurs, mais
le téléphone est détraqué.
Je dois donc
renoncer au désir de donner un
dîner. »
Le mari de cette
malade est boucher. Elle en est très éprise et le
taquine
sans cesse. Elle a demandé à son mari de ne pas
lui
donner de caviar. En réalité, elle souhaite
depuis
longtemps avoir chaque matin un sandwich au caviar et elle l'aurait, si
elle en parlait à son mari. En fait, cette personne veut se
créer un désir dans la vie insatisfait et ce
rêve
lui montre. Après une certaine insistance de Freud, la
malade
lui dit qu'elle a rendu visite la veille à son amie dont
elle
est fort jalouse parce que son mari en dit toujours beaucoup de bien.
Fort heureusement, l'amie est mince et maigre, et son mari aime les
formes pleines.
De quoi parlait donc cette personne maigre ? Naturellement, de
son
désir d'engraisser. Elle lui a demandé :
« Quand nous inviterez-vous à
nouveau ? On mange
toujours si bien chez vous. » Le sens du
rêve
apparaît clair maintenant, c'est comme si en rêve
la malade
lui avait répondu
mentalement : « Oui ! Je
vais t'inviter pour
que tu manges bien, que tu engraisses et que tu plaises plus encore
à mon mari ! J'aimerais mieux ne plus donner de
dîner
de ma vie ! » Le rêve dit qu'elle
ne peut donner
de dîner ; il accomplit ainsi son vœu de
ne point
contribuer à rendre plus belle votre amie. Cependant, il
manque
encore à quoi le saumon fumé répond
dans le
rêve. « C'est, dit-elle, le plat
de
prédilection de mon amie. »
Une autre interprétation est aussi possible, sans contredire
la
précédente, et prouve le double sens que
recouvrent les
rêves. La malade s'efforçait dans la
réalité
de combler un de ses désirs (le sandwich au caviar).
L'amie avait aussi exprimé un vœu, celui
d'engraisser, et
il n'y aurait rien d'étonnant à ce que la malade
eût rêvé qu'un souhait de son amie ne
s'accomplit
pas. Mais, au lieu de cela, elle rêve qu'elle même
voit un
de ses désirs non accompli. Le rêve acquiert un
sens
nouveau, s'il n'est pas question d'elle mais de son amie, elle s'est
identifiée à elle.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |